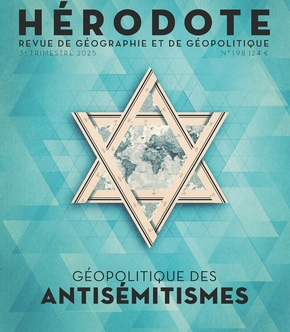Et dire que nous les avons accueillis chez nous ! » C’est par ces mots que Recep Tayyip Erdoğan, alors Premier ministre, exprimait sa profonde indignation au sujet des bombes que larguait Israël sur Gaza en l’hiver 2008-2009. Il faisait référence à l’accueil des Juifs sur les terres ottomanes après qu’ils ont été expulsés de la péninsule ibérique, à la fin du xve siècle. Cette référence historique sert à signifier l’hétérogénéité des Juifs à la nation turque. Bien que citoyens, ils sont un « héritage résiduel » de l’Empire ottoman, ils ont été « accueillis », ils sont « hébergés », « hôtes », ils sont tolérés. S’appuyant sur ce récit concernant « l’hospitalité » ottomane, la saillie d’Erdoğan induit que les Israéliens sont les descendants de ces Juifs « accueillis » comme le sont les Juifs de Turquie. Ainsi, issus des mêmes origines, ces derniers ne partagent-ils pas la responsabilité de ce que fait Israël aux Palestiniens ? M. Erdoğan soutient, héberge et protège le Hamas mais s’abstient en général de formuler les choses ainsi. La presse et les médias partisans le font à sa place. Lui sait assurément que pour l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), établissement international duquel Ankara souhaite devenir membre permanent, accuser des citoyens juifs d’être plus loyaux envers Israël, ou d’agir selon les priorités supposées des Juifs du monde entier, plutôt que d’obéir aux intérêts de leur propre pays est un exemple contemporain d’antisémitisme [1]. Et il ne souhaite pas donner l’image d’un antisémite sur la scène internationale.
Pour lire l’article sur la revue Hérodote cliquer ICI
En Turquie l’attribution d’une altérité irréductible aux Juifs sert de fondement à des « régimes d’antisémitisme/antijudaïsme » [2] distincts. Cet article traitera de trois régimes, avec leur logique, leur univers lexical singulier, à l’intersection desquels s’épanouit un antisémitisme institutionnel turc, et son reflet sur la population. Le premier de ces régimes, la turcification, correspond aux premières décennies de la République pendant lesquelles assurer la primauté de la population turque musulmane domine les pratiques et les mentalités. Les échos du nazisme sur la presse et sur l’action de l’État entre les deux guerres mondiales et pendant la deuxième sont constitutifs du second régime. À l’ère d’Erdoğan, le régime de répugnance envers les Juifs se modifie pour intégrer les motifs de l’antisémitisme devenus classiques, proférés par une presse partisane et qu’attise l’animosité de la Turquie envers Israël.
Régime d’antijudaïsme/antisémitisme 1. La turcification. L’obsession d’un territoire ethniquement-religieusement homogène
Au cours du dernier quart du xixe siècle, alors que l’Empire ottoman est en train de perdre les territoires européens sur lesquels l’élément turc-musulman n’est pas majoritaire, le sultan Abdülhamid II tente de renforcer les liens de la Sublime Porte avec ses provinces arabes [Georgeon, 2003]. L’islam sert alors de ciment à l’identité ottomane. Les non-musulmans, Grecs, Arméniens, Juifs deviennent suspects de déloyauté. Ce tournant advient trop tard et n’empêche pas l’Empire d’être démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale. Fondée en 1923 sur les ruines de ce qui fut un Empire plurinational, la République de Turquie métabolisera en doctrine démographique la conscience de ne plus pouvoir dominer les territoires où les Turcs musulmans ne sont pas majoritaires. On peut définir brièvement cette doctrine par la volonté d’obtenir et maintenir l’homogénéité ethno-religieuse sur ses territoires. Cela s’appellera « turcification » et se manifestera par des confiscations de biens, par des politiques discriminantes de l’emploi, de l’impôt, par des violences, des intimidations qui visent les non-musulmans. Brimades et persécutions s’exerceront, infléchissant la pensée, les mentalités, les identités conscientes et inconscientes.
Dès la création de la République, une partie de l’ambition de former une nation exclusivement turque-musulmane-sunnite est déjà partiellement atteinte, d’abord par le génocide arménien (1915) et puis par l’échange de populations avec la Grèce [3]. En 1923, la péninsule anatolienne est délestée de la grande majorité de sa population chrétienne. Un passif lourd pèsera désormais en Turquie sur la population résiduelle d’Arméniens et de Grecs. Ceux-là éliminés, restent les Juifs [4].
Les Juifs n’ont pas été victimes d’une tragédie comparable à celles que vécurent Arméniens et Grecs, leurs relations avec le jeune État turc auraient dû se déployer sous un ciel sans nuage [5]. Ce serait sans compter avec le nationalisme en action, l’anti–minoritarisme et les relents d’antisémitisme qui avaient pénétré l’ADN de l’administration et de la société civile turques. Rifat Bali, historien des Juifs en Turquie, cite un article de l’époque traitant des orientations du jeune État au moment de la création de la République.
Après s’être débarrassé de ses chaînes internes et externes avec persévérance et foi, le Turc a déclaré au monde entier qu’il était le seul maître dans ce pays. Après cette déclaration les Grecs et les Arméniens (…) qui vivaient comme des entités contre nature dans notre pays, ont fui par peur des représailles pour les crimes et les trahisons qu’ils ont commis. En revanche, l’entité juive qui n’a jamais exprimé ouvertement son inimitié sur la scène politique, est restée parmi nous en décorant son visage d’un sourire hypocrite qui convient à toutes les époques [6].
Dès janvier 1923 les journaux smyrniotes Türk Sesi (La voix turque) et Yanık Yurt (Pays brûlé), appellent les acteurs économiques turcs à s’unir et à lutter contre le « danger juif immoral et manipulateur ». Entre le 14 janvier et le 20 février 1923, se réunit le Congrès économique d’Izmir qui décidera des grandes orientations économiques du pays. La clause numéro neuf stipule que « le Turc [entendre le Turc musulman] n’entre pas en relation avec des organisations qui ne se conforment pas à sa propre langue et à son propre droit » [7]. Cette recommandation sera suivie dans la mesure où les domaines économiques purgés des Grecs et des Arméniens pourront être occupés par des Turcs musulmans. Cependant, on ne devient pas entrepreneur ou négociant en une génération après avoir vécu pendant des siècles d’activités professionnelles au service de l’État (ottoman). Il arrive que des hommes d’affaires juifs comblent les nouvelles lacunes. Ils sont alors qualifiés de « nids à microbes ». La revue satirique Akbaba [8] publie une série d’articles titrant : « N’avez-vous pas compris ce qu’on vous a dit ? Vous ne pouvez pas faire des affaires avec les Juifs » ou encore « Devrions-nous permettre à ces germes de vivre parmi nous ? ».
Suite à une série d’articles du même acabit dans le journal Pashaeli, les habitants d’Edirne se rassemblent au centre-ville et scandent : « Ce sera votre tour de quitter ce pays ! Juifs, dehors ! » La police parvient de justesse à empêcher la mise à sac des magasins juifs. Même dans de petites agglomérations de Thrace comme Babaeski, les Juifs partent abandonnant leurs biens. Ils se réfugient à Istanbul. Les écoles de l’Alliance israélite universelle de la région ferment.
Ces « réticences » envers les Israélites étaient déjà présentes lors des négociations du traité de Lausanne. Rıza Nur (1879-1942), politicien et écrivain turc, y participait et avait déclaré en mars 1923, lors d’une session secrète, qu’il ne devrait plus y avoir de minoritaires en Turquie, à l’exception d’Istanbul. « ll y a trente mille Juifs à Istanbul. Ce sont des gens qui n’ont pas causé de problèmes jusqu’à présent. Les Juifs, comme vous le savez, vont vers là où on les tire. Bien sûr, je dirai qu’il aurait mieux valu qu’ils ne soient pas là [9]… »
Dans la même veine, l’administration licencie Juifs, Arméniens et Grecs de la fonction publique et embauche à leur place des Turcs musulmans. Bien qu’aucune décision d’expulsion n’ait été prise à Lausanne, à Çorlu, sur la rive nord de la mer Marmara, les Juifs sont sommés de quitter la ville (décembre 1923) dans les 48 heures. L’intervention du grand rabbin obtiendra l’ajournement de la directive. En septembre 1929, le ministère des Finances taxe les écoles juives, l’hôpital Or Ahayim, l’orphelinat de Ortaköy (quartier sur les bords de la Corne d’Or) et les synagogues comme s’il s’agissait d’établissements commerciaux. Incapable de payer ces taxes, le grand rabbinat est saisi. La pression du gouvernement se poursuit et les dons que reçoit l’administration de la communauté sont étroitement surveillés. Les Juifs sont progressivement soumis à un étau économique.
La turcification s’applique principalement au sein du domaine économique et dans le champ linguistique. Il faut qu’elle soit perceptible sur l’espace public. La rue turque sera purgée des langues des non-musulmans et des Kurdes. Le 13 janvier 1928 démarre la campagne « Citoyen parle le Turc ». Tout le pays est couvert d’affiches qui assignent à parler turc. Dans les transports urbains, dans les commerces, de simples citoyens s’enhardissent, apostrophent et mettent en garde ceux qui s’expriment en judéo-espagnol, en arménien ou en grec. Les individus qui n’obéissent pas aux avertissements sont menacés, il arrive qu’ils soient battus et poursuivis en justice.
Lors des élections municipales d’octobre 1930, le journal Cumhuriyet, considéré jusqu’à aujourd’hui comme un organe de centre gauche, et le journal Anadolu « dénoncent » la présence de candidats grecs, arméniens et juifs sur les listes du nouveau Parti républicain libre, le SCF (Serbest Cumhuriyet Fırkası), et l’accablent d’anti-turquisme. « Comment pouvez-vous voter sans vergogne en faveur d’un parti pour lequel les Hamparsuns, Mishons et Georgios ont voté ? » Le Parti républicain du peuple, le CHF (Cumhuriyet Halk Firkasi) [10] met un point d’honneur à ne présenter aucun candidat non-musulman sur sa liste.
Dans les années 1930, pour les Juifs, le pire reste à venir. En Thrace, en 1934, des journalistes comme Cevat Rıfat Atilhan du Milli İnkılap (Réforme nationale) et Nihal Atsız de la revue Orhun, connus pour leur inimitié envers la population juive, publient des articles conspirationnistes qui provoquent des attaques contre les Juifs. Cela se passe dans les villes prospères d’Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski. Maisons et magasins juifs sont pillés, des femmes violées et un rabbin tué. À la suite de ces incidents, 15 000 Juifs fuient leur ville, abandonnent leurs biens et se réfugient à Istanbul ou quittent la Turquie [11].
Jusque-là, le champ lexical de la turcification est saturé de vocables évoquant la trahison, l’hypocrisie, la dissimulation, l’extériorité à la nation. Ils sont produits par l’obsession de faire « nation » sans minorités non-musulmanes. Dans cette équation, « turc » veut dire musulman. Cela est plutôt paradoxal car le kémalisme à l’œuvre considère que la religion fut un obstacle à la modernité visée. L’impulsion kémaliste tend à inhiber la religion et choisit un régime laïc. Si elle est un marqueur identitaire de la turcité, la religion musulmane des individus ne vaut que pour distinguer les « vrais » citoyens turcs des autres, chrétiens, juifs, alevis, shiites. Il n’en demeure pas moins que l’essor nationaliste fait des non-Musulmans un quasi ennemi intérieur. Dans ce contexte, ce n’est pas en convoquant la rhétorique propre à l’antisémitisme que s’exprime l’inimitié contre les Juifs. Celle-ci se déploie selon un lexique qui interroge encore la légitimité de la présence juive en Turquie alors que le but est de gouverner une population exclusivement turque musulmane sunnite.
S’est mis en place à cette période ce que l’historien Barıṣ Ünlü appelle « la Charte de la turcité » (Türklük sözleṣmesi) dans son brillant ouvrage éponyme (La Charte de la turcité) publié en 2018. « Selon l’article 1 de la charte de la turcité, pour pouvoir vivre parmi les privilégiés et en sécurité en Turquie, pour conserver le potentiel de s’élever dans la hiérarchie sociale, il est indispensable d’être musulman et turc. » [Ünlü, 2018]
Régime d’antijudaïsme/antisémitisme 2. « La Turquie havre de paix pour les Juifs ? » Les années 1930 et 1940
À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, le discours de la turcification s’enrichit des mots, des métaphores, des actions de l’antisémitisme moderne. Les vocables de leur détestation sont pris dans la rhétorique antisémite (parasites, microbes, sangsues) fondée sur l’idée de race et de particularités sociales (avides, cupides, exploiteurs, nomades, sans racines) et biologiques (nez crochu, etc.). Les mots qui, à la fin du xixe siècle, avaient eux-mêmes remplacé le lexique du christianisme européen, représentant « le peuple déicide ». Les patterns établis par la turcification continuent d’agir de manière plus souterraine. Ils accompagnent le nationalisme turc qui, dans les années 1930, aiguise son discours, le centralise, l’institutionnalise et crée de nouveaux organes, notamment dans l’éducation.
L’énergie du nazisme en Allemagne, les idées du fascisme en Italie séduisent des faiseurs d’opinion en Turquie. En janvier 1937, l’Office de l’information allemand s’installe à Caǧaloǧlu, quartier stambouliote des sièges sociaux des éditeurs de presse. Le journal de langue allemande Türkische Post publie de la propagande nazie. Les idéologies totalitaires de l’entre-deux-guerres contaminent une partie des zélotes de la turcification tel Yunus Nadi à la tête du quotidien Cumhuriyet qui se met à faire de la propagande nazie [12], à décrire l’efficacité de l’ordre fasciste en Italie.
En août 1938, le gouvernement adopte le décret no 2/9498 stipulant que « les Juifs dont les conditions de vie et les possibilités de voyage sont soumis à des restrictions dans les pays dont ils sont les sujets sont interdits d’entrer et de résider en Turquie, quelle que soit leur religion actuelle » [13]. C’est sur cette législation que s’appuiera l’État turc pour fermer ses frontières aux Juifs fuyant l’Europe nazie, notamment ceux de Bulgarie et de Roumanie qui s’entassent dans des bateaux de fortune tentant de rejoindre la Palestine. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect et sur le mythe d’une Turquie protectrice des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Toujours en 1938, les employés juifs de l’agence Anadolu, seule agence de presse officielle du pays, sont licenciés. On assiste à une explosion d’articles et de caricatures dans les journaux et les magazines, qui présentent les minorités en général et les Juifs en particulier comme responsables des problèmes du pays.
En 1942, alors que la violence nazie se déchaîne en Europe, Ankara décrète un impôt sur la fortune qui ruinera les familles juives et dans une moindre mesure les grecques et les arméniennes. Ceux qui ne peuvent payer les sommes exigées sont envoyés aux travaux forcés. Plus que l’ensemble des violences et brimades qui les touchèrent, c’est cet épisode qui laissera le plus de traces sur la mémoire des Juifs de Turquie. Il incitera à l’exode des Juifs de condition modeste vers Israël dans les années 1950.
Le climat, les événements des années 1930 et 1940 malmènent quelque peu l’image « territoire de refuge » de la Turquie notamment son rôle dans le sauvetage des Juifs que persécute l’Allemagne nazie. Le mythe du sauvetage repose sur le fait que, la Turquie ayant eu le statut de pays neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, les ressortissants turcs en Europe ne pouvaient être déportés. Ainsi, ceux qui en France, par exemple, disposaient d’un passeport turc ne furent pas inquiétés pendant les premières années d’occupation. À cela s’ajoute le récit de diplomates turcs qui s’étaient dressés pour protéger de la déportation les Juifs en Europe. En réalité, seul le consul turc de Rhodes, Selahattin Ülkümen (1914-2003), qui a refusé héroïquement que fussent déportés de l’île les Juifs sous sa juridiction, fut reconnu Juste parmi les nations par Yad Vashem (1989).
Un autre conflit hors Turquie a eu des conséquences dramatiques dans le pays : la question chypriote. Ses aléas fournissent prétextes à violences anti-minoritaires. Le pogrom de la nuit du 5 au 6 septembre 1955 a dévasté les commerces de la rue Istiklâl à Istanbul et terrorisé les non-Musulmans. Bien que ce fut l’affaire chypriote qui ait fourni le prétexte de ces violences, elles n’ont guère fait de différences entre les commerces grecs, arméniens et juifs. La rue Istiklâl, l’ancienne rue de Péra, mettra des décennies à retrouver de l’éclat.
Des travaux récents d’historiens [Guttstadt, 2013 ; Bahar, 2014] ont déconstruit ce mythe d’une Turquie qui aurait choisi de protéger les Juifs de la folie exterminatrice des nazis. La découverte du décret de l’Assemblé nationale turque qui interdit, dès 1938, l’entrée, même en transit, des Juifs sur le territoire turc a contribué à cette déconstruction. C’est sur cette loi que se sont appuyés les tragiques refus d’accostage opposés aux bateaux chargés de réfugiés juifs fuyant la Roumanie et la Bulgarie à l’approche de l’armée allemande. Ainsi le Salvador qui a fait naufrage en mer de Marmara en 1940. Il était parti de Varna pour la Palestine avec à bord 342 Juifs bulgares, adultes et enfants. Les autorités turques ont obligé ce « cercueil flottant » (il s’agit en fait d’un bateau pour 40 passagers) à poursuivre sa route. Il a fait naufrage au large de Silivri, banlieue d’Istanbul, aujourd’hui célèbre pour abriter le grand complexe pénitencier où les prisonniers politiques purgent leur peine. Seuls 123 passagers auront survécu à ce naufrage. Un an plus tard, le gouvernement turc récidivait en interdisant au Struma venant de Roumanie de débarquer avec ses 770 passagers et membres de l’équipage. Les moteurs du Struma étaient en panne. Après soixante-dix jours de quarantaine absolue dans le port d’Istanbul le paquebot est contraint de rompre les amarres. Il est remorqué en mer Noire où il fera naufrage, torpillé le 24 février 1942 par un sous-marin soviétique. À ce sujet le Premier ministre de l’époque, Refik Saydam, a déclaré que « la Turquie ne pouvait être un lieu (une destination) pour personnes non désirées par d’autres [pays] [14] ». Ignorée de l’histoire officielle, la tragédie du Struma n’a que récemment ressurgi dans la mémoire des Juifs. Aujourd’hui, ils la commémorent publiquement en présence du grand rabbin et des représentants d’instances municipales ou étatiques.
On sait que 40 000 Juifs furent déportés de Salonique et de sa région. Malgré la proximité, ils n’avaient pu trouver refuge dans cette Thrace orientale et turque dont les séparait la frontière récente avec la Grèce, établie depuis moins de dix-huit ans.
Un fait interdit cependant que l’on dénie complètement à la Turquie son rôle de refuge à des persécutés juifs. Il s’agit d’une centaine de professeurs allemands, en majorité juifs, qui viennent, dès 1933, travailler en Turquie avec leur famille et y résident parfois jusqu’aux années 1950. Ils sont invités pour fonder l’Université turque moderne. En effet, le résultat d’un rapport commandé en 1932 pour diagnostiquer l’état de l’enseignement supérieur dans les darülfünun (littéralement « maison des sciences ») insistait sur le caractère inadapté de ces établissements. Il préconisait la fondation d’une université au sens contemporain en précisant « avec des professeurs venus de Berlin, Liepzig, Paris ou Chicago » [Apter, 2006]. Chargé du recrutement, l’auteur du rapport reçut une réponse favorable essentiellement de la part de professeurs allemands ou germanophones. Ils avaient été chassés de leur poste ou préféraient se mettre à l’abri de la montée du nazisme. Installés à Istanbul et à Ankara, ils contribueront à fonder l’Université turque.
Hans Reichenbach, éminent spécialiste de la philosophie de l’esprit, arrive à Istanbul dès 1933. Gerhard Kessler installe l’enseignement de l’économie avec Fritz Neumark à l’université d’Istanbul et Paul Hindemith fonde le conservatoire d’État à Ankara avec Carl Ebert. Ils y attireront Béla Bartók, qui les rejoint en 1936. Le philosophe Ernst von Aster, l’orientaliste Clemens Bosch, les juristes Andreas Schwarz et Ernst Hirsch, le pédagogue Wilhelm Peters, le géologue Wilhelm Salomon-Calvi, le botaniste Hans Bremer viennent enseigner et fonder les départements correspondant à leur discipline. Les victimes allemandes du nazisme à qui on avait confisqué les emplois en Allemagne et en Autriche satisfont la politique de la jeune République turque pressée de s’occidentaliser en « réformant » l’université (parfois aux dépens de ceux qui étaient déjà en poste). Ils sont constitutifs de l’ADN de l’Université turque. (…) C’est à Leo Spitzer, philologue et théoricien de la littérature, installé à Istanbul entre 1933 et 1936, que l’on doit la création de l’actuel département de langue et littérature françaises de la faculté de lettres de l’université d’Istanbul. À l’instigation de Spitzer, Erich Auerbach, son collègue à l’université de Marburg, le rejoint à Istanbul en 1936. Il y reste jusqu’en 1947 [Seni, 2018, p. 82].
C’est à Istanbul qu’Erich Auerbach, fondateur de la littérature comparée en tant que discipline, a conçu et rédigé son opus major : Mimésis, La représentation de la réalité dans la littérature occidentale [Konuk, 2014].
Même si l’invitation n’avait pas pour but de « sauver » ces professeurs mais de bénéficier de leurs savoirs, l’opération aurait pu tourner court ou ne pas avoir lieu du tout si l’hôte turc était alors pétri d’un antijudaïsme virulent.
De toute façon, avec ou sans l’invitation de professeurs juifs allemands, le mythe d’une Turquie salvatrice des Juifs résiste. Mais n’est-ce pas le propre des mythes que de survivre au réel ? Dans ce cas précis, une autre raison favorise la permanence de cette légende : la Turquie compte sur la communauté juive pour témoigner de « l’hospitalité » dont elle a bénéficié et faire obstacle à l’accusation de génocide des Arméniens [Seni, 2016].
Vers la fin des années 1980, différentes instances internationales reconnaissent, comme le fait le Parlement européen en 1987, le caractère génocidaire des massacres des arméniens de 1915. À l’approche de 1992, date du 500e anniversaire de l’arrivée des Juifs ibériques sur les terres ottomanes, la Turquie décide en haut lieu de célébrer publiquement et avec faste cet anniversaire. Est ainsi créée la Fondation du 500e anniversaire par une centaine de personnalités turques, musulmanes et juives (diplomates à la retraite, hommes d’affaires). Ils organisent colloques et manifestations qui ont pour objectif d’étayer la perception publique de « havre de sécurité » que furent pour les Juifs les terres ottomanes d’abord, la Turquie par la suite. Le sous-texte de cette initiative est « la Turquie est héritière d’un empire qui cinq siècles plus tôt a pu accueillir les Juifs victimes d’une haine religieuse, on ne saurait la suspecter d’être capable de génocide ». On demandera donc à la communauté juive d’être garante de l’inaptitude au génocide de l’État turco-ottoman. Les Juifs joueront le jeu. Une des raisons qui les incitent à accepter cette « mission » est la vive réaction anti-israélienne des islamistes turcs lors de la première Intifada et leurs slogans antijuifs appelant à un régime islamique. S’assurer la protection du gouvernement est certainement la raison fondamentale qui incite la communauté juive à accepter cette entente tacite. Ce faisant, elle consent à la confiscation d’une partie de sa mémoire récente [15].
La Turquie prend d’autres mesures encore pour réfuter l’accusation de génocide des Arméniens. Elle pose sa candidature à l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), cette organisation fondée en 1998 constitue un réseau de trente-cinq pays membres qui « travaillent ensemble pour combattre l’antisémitisme et les distorsions de la mémoire qui s’attache à la Shoah et au génocide des Roms » [16]. La Turquie en est candidate depuis 2008 et occupe un statut d’observateur. Parmi les conditions d’adhésion, dont la reconnaissance des massacres et génocides passés, se trouve aussi l’obligation d’entretenir les lieux de mémoire des populations concernées. C’est une des raisons qui ont poussé l’État turc à restaurer des ruines de synagogues dans des villes où ne vivent plus aucun Juif, comme à Edirne ou à Cizre.
Régime d’antijudaïsme/antisémitisme 3. L’irruption d’Israël dans la rhétorique antisémite
L’antijudaïsme [17] fondé sur l’islam n’a pas été inventé en Turquie par l’actuel président. Si, sous l’Empire ottoman, il s’est transmis par des textes sacrés de l’islam, l’étude et la fréquentation systématiques de ces textes étant restées limitées [18] à des cercles restreints d’ulémas [19] pendant des siècles, leur influence s’est peu diffusée. Il n’y a pas eu, comme en Europe, transmission de la détestation des Juifs par un clergé pléthorique inséré dans le tissu social, en contact systémique avec la population des campagnes et des villes européennes, diffusant les représentations d’un peuple déicide. Dans les campagnes anatoliennes, peu ont entendu parler des Juifs pendant des siècles.
Quant à l’antisémitisme, il fait partie des caractéristiques revendiquées par le mouvement Millî Görüṣ (Vision nationale) qui a porté au pouvoir Recep Tayyip Erdoğan dans les années 1990. « Des Juifs et des francs-maçons ! C’est ce que nous voyons lorsque nous regardons de près ces pions qui avancent, masqués de noir, et qu’on appelle les médias. Il s’agit là de la face cachée d’un réseau d’oppression et de malfaisance ! » Les propos sont datés du 30 mars 1994, trois jours après l’élection d’Erdoğan à la mairie d’Istanbul. Ils sont publiés par le journal du mouvement Millî Görüṣ, le Millî Gazete (Journal national). Ravi du succès de leur poulain, le journal insulte la presse qui s’est opposée à l’élection d’Erdoğan en la qualifiant de repaire de Juifs ou de franc-maçons. Dans son champ lexical, les équations bien connues telles que juif = usurier = banquier.
L’islam politique est alors en train de faire ses premiers pas sur la scène turque. Il est porté par le parti Refah et accueilli comme une formation à laquelle il faut donner sa chance. Une grande bienveillance accompagne son essor de la part de la gauche intellectuelle, toujours nationaliste mais culpabilisée par la veine kémaliste, qui tenait à inhiber la religion et ce faisant pénalisait les populations qui tenaient à l’islam traditionnel. Un nouveau « politiquement correct » était né qui n’excluait plus la religion de l’identité désirée par l’intelligentsia pro-occidentale.
Des intellectuels faisaient bouger les choses en demandant pardon aux Arméniens. Leur action faisait le lien avec l’opinion européenne qui avait reconnu de longue date le caractère génocidaire des massacres de 1915. On évoquait aussi les drames suscités par l’échange des populations avec la Grèce, on était nostalgique d’un quotidien partagé avec des voisins grecs. Quant aux Juifs, ils n’avaient pas vécu de tragédies comparables. Ils n’avaient pas demandé à être protégés par des pays tiers lors du traité de Lausanne en 1923. Ils avaient joué la carte d’une intégration discrète et citoyenne, mais voilà qu’avec le temps, le mot d’ordre « pas de vague » était devenu leur doctrine. Dès lors, s’afficher en faveur des Juifs ne pouvait apporter aux intellectuels ni la satisfaction de pouvoir « protéger » une minorité qui n’occupait pas l’espace publique par des demandes de réparation ou des réclamations identitaires, ni susciter en eux un sentiment de résistance héroïque au nationalisme dominant.
Ainsi, bien que scrutées par tous, les saillies proprement antisémites de l’islam politique ne sont relevées ni par la presse, ni par les mouvements politiques rivaux, ni même par l’intelligentsia, y compris les intellectuels de gauche. La pléthore d’ouvrages, d’articles sociologiques qui analysent la montée de l’islam politique, qui interprètent le moindre de ses résultats électoraux fief par fief ne relève nullement la veine raciste qui traverse la rhétorique de ce mouvement, le premier depuis la République à s’afficher « musulman conservateur ». Ce n’est pas tellement l’absence des indignations-condamnations qui seraient survenues en Europe qui surprend. C’est que l’antisémitisme ne fait pas sens, n’appelle aucune analyse, commentaire, interprétation. Il est sensé ne rien dire de la nature politique du mouvement qui s’en réclame. Ce n’est pas un sujet, ce n’est pas un symptôme de mépris de démocratie. Les intellectuels et les chroniqueurs « progressistes » voulant voir dans ce courant islamiste les prémices d’un parti démocratie-compatible à la manière des chrétiens-démocrates, n’interrogent jamais son antisémitisme.
Comment comprendre « l’insignifiance » de ce racisme sur la scène politique et culturelle en Turquie ? Certes la Turquie n’a pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce la seule raison de l’insistante indifférence du monde intellectuel, de l’éducation, des lettres et des médias, au désastre de la dernière guerre mondiale et à la destruction des Juifs d’Europe ? Alors que l’univers post-1945 se sature d’ouvrages, de témoignages, d’œuvres qui interrogent l’irruption de la barbarie au sein de ce qu’on avait pris l’habitude de considérer comme la civilisation la plus aboutie, l’imaginaire en Turquie reste indifférent, fermé à cette sidération et à ses questionnements. Aucune création artistique, roman, film, série ne faisait jusqu’à très récemment référence à ces sujets. Peu de programmes universitaires, sinon aucun, sur la période 1933-1945, peu de traductions en turc de la pléthore d’ouvrages se rapportant à cette parenthèse tragique alors qu’en Turquie on suit de près le monde éditorial occidental [20]. Les débats sur les processus de destruction nazis qui ont ébranlé la conscience universelle interrogeant la notion de civilisation ne semblent pas avoir pénétré la pensée, les arts, la culture en Turquie. Si l’antisémitisme est devenu en Europe un marqueur de l’extrême droite après la Seconde Guerre mondiale, perçu comme un symptôme d’aspirations anti-démocratiques, la notion ne résonne pas en Turquie comme un danger, une menace contre la paix et la démocratie. Il en a résulté une certaine incapacité à lire et à interpréter non seulement la rhétorique de l’Islam politique comme une aspiration autoritaire mais aussi à reconnaître – lorsqu’il était encore temps – la progression du régime d’Erdoğan vers une autocratie. Bluffés par les scores électoraux, d’abord du Refah, et puis de l’AKP (parti d’Erdoğan), les commentateurs turcs n’ont retenu qu’un seul critère qui mesure la propension à la démocratie des islamistes : leur participation au jeu électoral ! On a oublié que l’histoire récente a produit des monstres sortis des urnes.
La Seconde Guerre mondiale et ses génocides a généré, en occident, un credo, « plus jamais ça ! », qui a guidé les politiques et les institutions européennes et internationales de l’après 1945. L’objectif quasi sacré était de maintenir la paix, coûte que coûte. Tandis qu’en Turquie, c’est encore le souci d’une société homogène qui continua à irriguer la chose politique. Aujourd’hui, alors que les non musulmans constituent une portion congrue de la population, tout se passe comme si c’était aux Kurdes, aux Alevi que l’on faisait jouer les éléments hétérogènes.
Recep Tayyip Erdoğan ne renia guère le terreau islamiste et antisémite du Millî Görüṣ qui le porta au pouvoir. Cependant, il quitta le Refah pour former son parti, l’AKP, à qui il fit gagner les élections, et devint Premier ministre en 2002. Il en fit un parti Europe-compatible et gomma les expressions de haine xénophobe et antisémite.
Les choses changèrent à partir de 2007, lorsque le projet d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne fut démoli par la chancelière allemande et le président français. Pour Ankara débuta un lent processus de rapprochement avec le monde arabo-musulman, visant un leadership régional et l’émancipation relative de ses alliances occidentales. La protection des Palestiniens devint l’axe majeur de cette stratégie et amena un discours d’abord critique puis haineux vis-à-vis d’Israël.
Aujourd’hui, l’ambition de puissance d’Erdoğan, sa politique de leadership du monde musulman et son corolaire, la défense des Palestiniens, adressée à la rue arabe, implique de désigner Israël et les Juifs comme responsables de l’insécurité du monde. Bien qu’il ait condamné l’antisémitisme, son langage, ses harangues, son soutien au Hamas, la haine qu’il déverse sur Israël, dont il déclare souhaiter la destruction pure et simple, incite les media et les confréries qui le soutiennent à s’exprimer avec violence. Ainsi, le quotidien Yeni Akit va jusqu’à diffuser un classique de la littérature antisémite, la « calomnie de crime rituel » [21]. On connaît les dégâts causés par cette accusation, notamment les conséquences de l’affaire de Damas [22]. Yeni Akit et Millî Gazete, journal de la mouvance Vision nationale, se sont spécialisés dans le déversement de haine visant les Juifs, mais aussi les Arméniens, les Grecs, les Kurdes.
C’est à l’occasion de l’opération militaire israélienne « Plomb durci », menée sur Gaza dès la fin décembre 2008, que le président turc exprima ses regrets pour l’accueil fait aux Juifs d’Espagne et du Portugal fin xve siècle. Pour lui, les Israéliens sont tous les descendants de ces Juifs ibériques comme le sont les Juifs de Turquie. Ce continuum lui permet, par un raccourci dont les antisémites ont le secret, de rendre responsable la communauté juive de Turquie des faits et gestes du gouvernement israélien. Après le 7 octobre 2023, ses déclarations, son soutien bruyant au Hamas ont pris des dimensions qui, visiblement, inquiètent la communauté juive. La journaliste Karel Valensi, chroniqueuse au Şalom, hebdomadaire de la communauté juive, déclare au Deutche Welle le 27 octobre 2023 :
Ce que nous voyons dans la rhétorique des politiciens turcs, de la presse et des médias sociaux, c’est que les Juifs sont complètement écartés de la position de citoyens de la République de Turquie et transformés en ambassadeurs et en prolongements de l’État d’Israël, et la colère contre cet État est dirigée contre les Juifs turcs.
Selon l’IHRA, faire porter la responsabilité des actions d’Israël à des Juifs dans d’autres pays du monde est en soi un antisémitisme. Valensi a confié aussi que cette forme se généralise dans le discours public où sont diffusés des commentaires glorifiant Adolf Hitler et les idéologies nazies.
Au conflit entre Israël et le Hamas s’ajoute aujourd’hui la rivalité militaire entre la Turquie et Israël au sujet de la Syrie. Le 3 mai 2025, des avions de guerre turcs ont affronté des chasseurs israéliens dans les cieux syriens. Si ces confrontations au sujet de la Syrie, et qui impliquent Israël, se poursuivent, les angoisses de la communauté juive en Turquie n’auront que peu de chance de s’estomper.
Nora Seni
- Apter E. (2006), « Translatio globale. L’invention de la littérature comparée, Istanbul 1933 », Littérature, no 144, p. 25-55.
- Bahar I. (2014), Turkey and the Rescue of European Jews, Routledge.Consulter
- Bali R. (1999), Bir Türkleṣtirme serüveni (1923-1945), Iletişim.
- Georgeon F. (2003), Abdulhamid II, Le sultan calife, Fayard.
- Guttstadt C. (2013), Turkey, the Jews, and the Holocaust, Cambridge University Press.
- – (2023), Antisemitismus in und aus der Türkei, IKW.
- Konuk K. (2014), « Erich Auerbach à Istanbul. L’exil comme distance critique », Revue germanique international, no 19, p. 93-102.
- Seni N. (1984), « Ville ottomane et représentation du corps féminin », Les Temps Modernes, juillet-août, p. 66-95.
- – (2016), « A breakdown of Memorial Processes in Turkey », in Guttstadt C., Lutz T., Rother B. et San Roman Y. (dir.), Bystanders, Rescuers or Perpetrators? The Neutral Countries and the Shoah, Berlin, Metropol Verlag and IHRA, p. 289-301.
- – (2018), « Université et pouvoir politique en Turquie », Hérodote, no 168, p. 79-89.
- Ünlü B. (2018), Türklük Sözleṣmesi, Dipnot.