Le 24 avril 1915 marque le début du génocide des Arméniens. Cent neuf ans après, l’arme judiciaire continue, dans la Turquie d’aujourd’hui, à être employée au service de l’histoire officielle (toujours négationniste) contre les acteurs engagés dans un travail de confrontation avec le passé, de mémoire, et de reconnaissance.
AOC, le 25 avril 2024, par Adnan Çelik
Durant la plus grande partie du XXe siècle, la censure a été dans la Turquie républicaine le moyen essentiel d’empêcher l’expression et la circulation d’un grand nombre de récits et d’idées dérangeants pour le pouvoir ou l’histoire officielle.
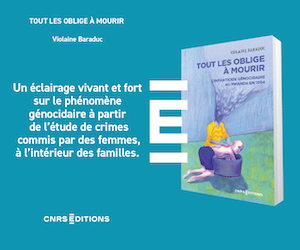
Un contrôle et une surveillance étroite de tous les contenus (ouvrages, revues, journaux, émissions de radio et de télévision) sont ainsi parvenus à maintenir sous une épaisse chape de silence les événements de 1915. Depuis les années 1990, cette chape a commencé à être fissurée par des questions et prises de paroles de plus en plus nombreuses, quittant la sphère privée et l’intimité des foyers pour s’imposer dans le débat public.
Nous avons relaté ailleurs comment ces voix, particulièrement fortes dans la région kurde depuis deux décennies, dans une véritable quête de confrontation avec le passé, ont engagé un véritable travail de mémoire à propos du génocide des Arméniens orchestré par le pouvoir ottoman, questionnant aussi la participation et la responsabilité de leurs ancêtres. Ce processus de confrontation et de reconnaissance, à travers une constellation d’initiatives matérielles, symboliques et morales a connu son point culminant avec la commémoration du centenaire de 1915 à Diyarbakır [1].
Si la politique négationniste du régime républicain turc a depuis son instauration employé une grande variété de moyens pour contrer l’existence et la diffusion de mémoires contrevenant au « roman national turc » dans les contre-publics puis dans la sphère publique en Turquie, nous constatons depuis les années 2000 sous le régime de l’AKP une inflation du recours aux procédures judiciaires à l’encontre d’individus ou institutions ayant soulevé, dans des publications ou des déclarations, la question du génocide des Arméniens.
Cette inflation n’est pourtant pas linéaire : les vagues d’enquêtes et de poursuites ont concerné deux périodes, séparées par une accalmie d’une décennie : 2004-2008, et depuis 2018. Par ailleurs, comme nous le verrons, toutes les enquêtes n’aboutissent pas à des poursuites, et ni ls poursuites à des condamnations, si bien que l’on peut questionner les motivations, logiques ou stratégies auxquelles ces attaques semblent répondre. Sans pouvoir nous appuyer sur l’intégralité des résultats des enquêtes ouvertes et poursuites intentées (dont un certain nombre, pour la deuxième vague, sont actuellement toujours en cours) nous souhaitons en restituer la teneur, et nous demander quelles dynamiques, ruptures et continuités révèlent les usages judiciaires de « l’insulte à la nation » pour réprimer la parole relative au génocide dans la Turquie des deux dernières décennies.
Nous nous intéresserons d’abord aux textes juridiques qui autorisent en Turquie la criminalisation de la reconnaissance du génocide, et à la conjoncture politique particulière qui caractérisait, sous le premier mandat d’Erdoğan, la première vague de poursuites engagées entre 2004 et 2008. Puis nous nous pencherons sur la seconde période en proposant un récapitulatif des enquêtes et procès intentés depuis 2018[2], afin de mettre l’accent sur les transformations profondes du contexte qui, tant au niveau de la politique intérieure qu’extérieure de la Turquie, ont présidé à ce regain [3].
L’article 301 et « l’insulte à la nation turque »
Aujourd’hui en Turquie, la liberté d’expression est entravée par des réglementations légales dont le contenu est ambigu et qui peuvent être interprétées de diverses manières. L’obstacle le plus significatif à la liberté d’expression concernant la reconnaissance du génocide est l’article 301 du code pénal turc, qui réprime le délit de « dénigrement public de la nation turque, de l’État de la République de Turquie, de la Grande Assemblée nationale de Turquie, du gouvernement de la République de Turquie et des organes judiciaires de l’État ». D’autres articles, tels que les articles 216 (« incitation du public à la haine et à l’hostilité ») et 220/6 (« commettre un crime au nom d’une organisation sans en être membre ») du code pénal turc, l’article 7/2 (« faire de la propagande pour une organisation terroriste ») de la loi antiterroriste, ainsi que l’article 299, qui réglemente l’insulte au Président de la République, sont eux aussi fréquemment utilisés pour restreindre l’exercice effectif de la liberté d’expression.
Précisions que l’article 301 a été introduit dans le cadre des réformes législatives du 1er juin 2005, en remplacement de l’article 159 de l’ancien code pénal, et qu’en avril 2008, l’article qui pénalisait « l’insulte à la turcité » a été amendé par le Parlement, au terme d’un débat difficile. Seuls les parlementaires de l’AKP, alors majoritaires, ont voté cette réforme (pourtant légère) de l’article 301. Depuis cette date « l’insulte à la turcité » est remplacée par « l’insulte à la nation turque », les peines encourues sont réduites, et l’autorisation du ministre de la Justice est désormais requise pour toute procédure judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne mise en cause au titre de cet article [4].
Ces transformations relèvent, comme nous le verrons plus en détail, de lutte internes dans les sphères internes du pouvoir, notamment entre les représentants de « l’État profond » (cercles kémalistes et paraétatiques ultra-nationalistes) et les partisans de l’AKP majoritaires au gouvernement, dans le contexte spécifique du premier mandat du président Erdogan. Alors que « l’ouverture kurde », « l’ouverture alévie » et « l’ouverture démocratique » promises par le parti présidentiel, soutenues par le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, suscitaient de grands espoirs de transformation, les acteurs attachés à la République turquiste intransigeante de la période antérieure, très largement présents au sein des instances judiciaires, ont utilisé l’article 301 pour inquiéter les défenseurs des minorités et des droits et liberté mettant publiquement en cause l’histoire officielle.
Toutefois, en dépit de ces modifications, les termes vagues et généraux de l’article 301 permettent toujours de transformer en infraction un grand nombre d’opinions critiques.
Depuis le début des années 2000 et en dépit des restrictions apportées par la réforme de 2008 (notamment la nécessité de l’autorisation du ministère de la Justice pour poursuivre en Justice) l’article 301 du Code pénal turc a servi et continue de servir à intimider ou inculper un grand nombre de défenseurs des droits humains, journalistes et autres membres de la société civile pour des paroles prononcées.
Première vague d’enquêtes et de procès contre les auteurs de déclarations reconnaissant le génocide des Arméniens (2004-2008)
Avant d’entrer dans le détail de la première vague de procès de la décennie 2000, il me paraît intéressant de signaler deux antécédents judiciaires. Le premier (et seul à notre connaissance survenu avant les années 1990 relativement au génocide des Arméniens) nous est rapporté dans ses mémoires par Musa Anter, écrivain et figure emblématique de la cause kurde, né en 1918 et assassiné par le JITEM[5] turc (Service de renseignement et de lutte contre la terreur de la Gendarmerie) en septembre 1992, année de la parution du deuxième volume de ses mémoires. Lui-même se décrivait comme « à la fois victime, accusé, témoin, défendeur et plaignant » du XXe siècle. À la suite du coup d’État militaire du 12 mars 1971, Musa Anter a fait partie des centaines de Kurdes arrêtés et incarcérés à la prison du commandement de l’administration spéciale de Diyarbakır. Évoquant divers aspects de son séjour en prison (où il resta trente-deux mois avant d’être jugé), Anter relate cette anecdote :
« J’avais rédigé un récit [en prison] décrivant de manière poignante le génocide des Arméniens survenu à Çüngüş [district de Diyarbakir]. Je pense que c’était le premier récit réaliste sur le génocide arménien rédigé en Turquie. J’avais échangé avec des individus détenant des informations sur le génocide, des témoins encore en vie de ces événements, et approfondi mes recherches au point d’identifier le lieu exact de ces tragiques événements. L’origine de ces informations remontait à Mehmet Bey, fils de Güllü Agha qui travaillait en collaboration avec le Dr Reşit Bey, le gouverneur de Diyarbekir, surnommé ‘le boucher’. Le juge m’a demandé : “Musa Anter, êtes-vous d’origine arménienne ?”. J’ai répondu : “Non. Je suis d’origine kurde, mais nous sommes unis aux Arméniens dans la catastrophe.” Finalement, ils ne voulaient probablement pas que cette affaire soit éclairée davantage, ils ont donc détruit la version des faits et m’ont acquitté. »[6]
Cet épisode est révélateur, et nous permet de mieux saisir, par contraste, la nouveauté que constitue l’emploi des poursuites judiciaires dans la défense de l’Histoire officielle promue par l’État turc.
Le second antécédent survient au début de la décennie 1990, et revêt un caractère hybride annonciateur des transformations de la décennie suivante. Dans un contexte plus large de réveil des mémoires et de prise de parole des minorités en Turquie, la maison d’édition Belge décide de briser « Le tabou arménien » (Ermeni Tabusu), en faisant traduire et paraître sous ce titre, à l’automne 1993, le livre d’Yves Ternon Les Arméniens, histoire d’un génocide, initialement paru en France en 1977 aux éditions du Seuil. Bien que les co-fondateurs de Belge, Ragıp Zarakolu et Ayşe Nur Zarakolu, se soient abstenu d’employer le mot « génocide » dans le titre de l’ouvrage, cette publication consacrée aux évènements de 1915, une première dans l’histoire de Turquie, n’en eut pas moins un effet retentissant et immédiat auprès des autorités turques, qui réagirent doublement. D’abord le livre fut saisi (le jour de sa livraison à la maison d’édition) et interdit de vente, un procédé relevant de la pratique coutumière de la censure. Deuxièmement, en sa qualité de directrice de la maison d’édition, Ayşe Nur Zarakolu fût inculpée en vertu de la loi antiterroriste (TMK), promulguée en 1991 pour réprimer le mouvement politique kurde dirigé par le PKK. Le procureur à l’initiative de ces poursuites, requérant en outre l’arrestation immédiate de l’inculpée, affirmait que Madame Zarakolu, par la publication de ce livre, s’était rendue coupable de « propagande en faveur du séparatisme ». L’affaire fut portée devant la Cour de sûreté de l’État d’Istanbul en 1994 (qui prononça une condamnation à deux ans de prison ferme), en appel devant la Cour de Cassation (qui annula la peine prononcée sur la base d’un amendement à l’article 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme), avant de se solder en dernière instance, en 2003, suite au décès de l’accusée, par la prononciation d’une peine de 6 mois de prison commuée en amende [7].
Il est difficile de savoir dans quelle mesure la mort Ayşe Nur Zarakolu, première inculpée officielle de l’histoire de la Turquie républicaine pour une publication relative au génocide des Arméniens, a pesé dans la sentence finale. Mais cette affaire permet déjà de sentir l’embarras et les ambivalences de la machinerie judiciaire sur une affaire aussi sensible : la longue procédure de plus de huit ans ne débouche pas sur un verdict franc, mais sur un compromis qui respire la demi-mesure. La Justice n’ose prendre ni la responsabilité d’un acquittement, ni celle d’une lourde condamnation. Cet embarras et cette hésitation vont devenir monnaie courante dans les décennies suivantes, où le recours aux institutions judiciaires pour arbitrer ce type de litige va intégrer, en diverses occasions, l’ordinaire.
À partir des années 2000 cependant, c’est le fameux article 301 (ou son prédécesseur, l’article 159), et non plus la législation antiterroriste, qui sont invoqués de préférence pour inquiéter les auteurs de déclarations ou de publications considérées comme inacceptables par les partisans du roman national.
Concernant le génocide des Arméniens, la première affaire engagée au XXIe siècle a visé Akın Birdal, à l’époque vice-président de la Fédération internationale de la Ligue des Droits de l’homme (FIDH). À la toute fin de l’année 2000 le bureau du procureur d’Ankara dépose plainte contre lui, l’accusant d’avoir déclaré lors d’une table ronde tenue en Allemagne le 20 octobre précédent : « Un génocide a été commis contre les Arméniens. La Turquie devrait présenter ses excuses ». Il sera finalement acquitté en 2003[8] par la deuxième cour criminelle supérieure d’Ankara, non en vertu de la liberté de parole et d’opinion, mais d’un manque de preuves suffisantes. C’est officiellement ce qui a permis au journaliste et défenseur des droits humain d’échapper à la peine d’emprisonnement prévue par l’article 159 du code pénal [pour « insulte à la turcité »][9].
Mais c’est entre 2004 et 2008 que pour la première fois, une vague d’affaires visant des déclarations sur le génocide des Arméniens occupa sans discontinuer les arènes judiciaires du pays. Durant cette période, 8 enquêtes ont été ouvertes, dont 6 ont débouché sur des procès. Les personnes visées étaient des intellectuels et écrivains renommés.
La première visa Hrant Dink et Karin Karakaşlı rédacteurs en chef de l’hebdomadaire bilingue turco-arménien Agos, édité à Istanbul depuis 1996. Datant d’avril 2004 avant la réforme de 2005, l’action pénale est intentée une nouvelle fois au titre de l’article 159, « dénigrement de la turcité ». Par un jugement du 7 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Şişli (Istanbul) déclara Hrant Dink (en tant que responsable des publications) coupable et prononça une condamnation à 6 mois d’emprisonnement (avec sursis car c’était sa première comparution en Justice). La phrase incriminée figurait dans un article intitulé « Faire la connaissance de l’Arménie » où l’on pouvait lire : « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie ». Hrant Dink fut par la suite poursuivi plusieurs fois au titre de l’article 301 (« insulte à la nation turque ») pour plusieurs articles dans lesquels apparaissait le mot « génocide ». Mais son assassinat en plein cœur d’Istanbul le 19 janvier 2007 conduisit le tribunal correctionnel, devant lequel les dossiers avaient été renvoyés en appel, à classer l’affaire.
À partir de 2005, une série de procès vise tour à tour une série d’autres intellectuels renommés. Le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk fût inculpé au titre de l’article 301 pour ses propos dans un entretien accordé au Tages Anzeiger, un journal suisse, le 5 février 2005. Il y déclarait, évoquant l’état de la démocratie en Turquie, sans pourtant prononcer le mot de génocide, que « 30 000 Kurdes et un million d’Arméniens » avaient été tués [10]. L’éditeur Ragip Zarakolu fut ensuite poursuivi à plusieurs reprises. D’abord en mars 2005 pour « insulte à la mémoire d’Atatürk » (aux termes de la Loi n°5816) pour avoir publié la traduction turque d’un livre de George Jerjian intitulé The Truth Will Set Us Free: Armenians and Turks Reconciled[11], puis en mai pour la traduction du livre de Dora Sakayan Les épreuves d’un médecin arménien[12] (d’abord au titre de l’article 159, pour « dénigrement de l’identité turque et des forces de sécurité », inculpation modifiée après l’entrée en vigueur l’article 301 du nouveau code pénal en « dénigrement de l’État et de la République ». Puis ce fut au tour de l’historien Taner Akçam, au motif d’une chronique publiée le 6 octobre 2006 dans le journal Agos, dans laquelle Akçam prenait la défense de Hrant Dink et exhortait les lecteurs à se joindre à une campagne de soutien, en ces termes : « si prononcer le mot de génocide est un crime, alors je suis moi aussi complice de ce crime »[13]. Les poursuites, intentées en janvier 2007 ont cependant été abandonnées le 30 janvier par décision du tribunal d’Istanbul, 12 jours après l’assassinat du journaliste. Précisons qu’en octobre 2011, Taner Akçam a obtenu raison devant la Cour européenne des droits de l’homme, estimant que les lois turques contre le « dénigrement à la turcité » constituaient une violation de la liberté d’expression [14].
De fait, après l’assassinat de Hrant Dink, bien que ne débouchant plus sur des condamnations, des poursuites continuèrent être engagées par des procureurs fervents défenseurs de l’histoire officielle et de la nation turque, et ce même après les amendements apportés en 2008 à l’article 301, justement pour rendre plus difficiles l’engagement de poursuites. L’écrivain Temel Demirer fut ainsi inculpé en 2008, au lendemain même de l’entrée en vigueur des amendements, pour les propos qu’il avait tenus lors d’une manifestation de protestation à Ankara le 20 janvier 2007 suite à l’assassinat de Hrant Dink. Il y avait déclaré, dans la lignée de propos tenus par Taner Akçam dans Agos : « Nous devons commettre un crime pour que ce qui est arrivé à nos frères arméniens hier n’arrive pas à nos frères kurdes aujourd’hui. Je vous appelle tous à commettre un crime [en disant] : “oui, il y a eu un génocide arménien dans ce pays” ».[15] L’acte d’accusation rédigé par le procureur Levent Savaş précisait que « les déclarations du suspect [allaient] à l’encontre de la thèse officielle turque » et Mehmet Ali Şahin, ministre AKP de la Justice à l’époque cibla directement l’écrivain lors d’une interview, s’exclamant qu’il ne pouvait tolérer que l’État soit qualifié de « meurtrier ». Notons que le procès de Temel Demirer a duré plus de cinq ans, avant de « se perdre dans les limbes » : toujours en cours en 2013, on trouve dans la presse la mention d’un report du jugement trois ans plus tard (!) avant d’en perdre les traces. On sait cependant qu’il n’a pour l’instant débouché sur aucune condamnation, car toutes sont répertoriées dans les rapports de l’Association de défense des droits humains (IHD).
Le dernier épisode de la première vague de poursuites pénales dans les affaires liées au génocide des Arméniens a été l’ouverture en janvier 2009, par le procureur général d’Ankara, Nadi Türkarslan, d’une enquête en vue de poursuivre les initiateurs de la campagne de pétition « Je demande pardon ». Lancée en décembre 2008 par des intellectuels et journalistes tels qu’Ahmet İnsel, Baskın Oran, Cengiz Aktar et Ali Bayramoğlu, cette campagne appelait les intellectuels du pays à signer massivement une déclaration affirmant notamment : « Ma conscience ne peut accepter que l’on reste indifférent à la Grande Catastrophe que les Arméniens ottomans ont subie en 1915, et qu’on la nie. Je rejette cette injustice et, pour ma part, je partage les sentiments et les peines de mes sœurs et frères arméniens et je leur demande pardon. »[16] Au terme d’un an de procédures, la Cour de cassation a finalement rejeté les plaintes déposées (en première instance, puis en appel après un premier rejet) par la 1ère Cour pénale supérieure de Sincan et décidé de ne pas poursuivre : aucune action en justice n’a été intentée contre les organisateurs de la campagne.[17]
Pour comprendre le contexte de déploiement et les enjeux de cette première vague judiciaire dédiée à la question du génocide, il faut avoir en tête plusieurs éléments. Tout d’abord, elle semble avoir été motivée par la tentative de limiter la montée en puissance, sur la scène internationale aussi bien qu’en Turquie, de la mémoire de 1915. Depuis 2001 était discuté le projet de loi visant, en France, à criminaliser la négation du génocide. D’autre part les articles d’Agos, notamment celui de Hrant Dink affirmant en 2004 que Sabiha Gokçen était d’origine arménienne, avait suscité polémiques, controverses et scandales, amplifié par l’organisation en 2005 d’une conférence sur les Arméniens par trois université stanbouliotes (Bilgi, Boğaziçi et Sabancı).
En réaction, dans un contexte où l’élection de l’AKP de la première période semblait annoncer une phase de libéralisation et menaçait de bouleverser le règne de l’État profond, certains de ses éléments les plus actifs lors du conflit des années 1990 avec les Kurdes et les factions nationalistes, utilisèrent leur influence sur l’appareil judiciaire pour tenter de protéger la « raison d’État » qui avait présidé à leur politique et tenter de la sauver. La question arménienne n’était alors qu’un aspect des multiples vérités officielles à protéger. Des figures telles que Kemal Kerinçsiz, célèbre avocat nationaliste turc et directeur de la Grande Union des Juristes (Büyük Hukukçular Birliği), Veli Küçük, l’un des dirigeants du JITEM, ou Oktay Yıldırım, chantre de la « lutte anti-terroriste » au sein des forces armées turques, se sont servi des attaques judiciaires comme tremplin pour la mobilisation des forces nationalistes.[18] Kemal Kerinçsiz, responsable de la plupart des procès intentés dans la période au titre de l’article 301 (dont une quarantaine contre des journalistes ayant défendu le droits des minorités ou dénoncé les exactions commises au Kurdistan), est l’artisan principal des accusations lancée contre Hrant Dink, et des campagnes médiatiques concomitantes, qui ont conduit à l’assassinat du journaliste. La foule étaient appelée à manifester lors de ces audiences, et nombreux furent les rassemblements coordonnés devant les palais de justice en vue de protester, insulter et agresser les écrivains et défenseurs des droits de l’homme inculpés et leurs soutiens.[19]
Au début de la décennie 2000, la lutte contre les « thèses arméniennes » s’inscrivait donc dans le champ plus large de la lutte entre l’État profond et l’islam politique « libéral » alors promu par l’AKP. Le 25 mai 2001, un « Conseil de coordination pour la lutte contre les fausses allégations de génocide » (Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu) fut créé par une circulaire du Premier ministre. Il est très difficile déterminer la part respective de chacune des deux tendances mentionnées et du rapport de force entre elles dans la décision de création de cette institution destinée à « informer » l’opinion publique nationale et internationale en prouvant que les événements de 1915 n’étaient pas un génocide,[20] mais elle montre qu’au-delà des divergences et de la lutte pour le pouvoir, les bases d’un terrain d’entente négationniste existait déjà entre parti gouvernemental et éléments de l’État profond.
En tout état de cause cependant, ni les réactions extrêmes des éléments les plus farouchement négationnistes et anti-arméniens, ni l’utilisation de l’article 301, n’ont freiné l’essor du réveil de mémoire et de la quête de liberté de parole, de reconnaissance et de justice qui s’était emparée d’une bonne partie de la société civile en Turquie. On peut même émettre l’hypothèse que ces aspirations, à l’issue d’un siècle particulièrement oppressif et violent, furent exacerbées par ces attaques, à l’heure où une nouvelle donne politique et géopolitique semblait justifier les espoirs de changement.
La profonde interconnexion des questions kurde et arménienne en Turquie
Avant d’étudier la seconde vague d’utilisation de l’arme judiciaire qui, dans un contexte profondément différent, après une accalmie d’une décennie, s’abat depuis 2018, contre les acteurs de la reconnaissance du génocide en Turquie, il nous faut remarquer l’importance de l’interconnexion entre les questions kurde et arménienne, en soulignant leurs points de rencontre dans la période post-2000. On peut schématiser la succession de deux séquences : une période d’expansion (2002 à 2015), puis une période de recul (depuis 2015) de l’espace démocratique en Turquie. La première a favorisé l’émergence et la propagation d’un travail de mémoire, la seconde son déclin rapide, sous la pression de la réactivation de l’habitus répressif et du tropisme autoritaire de l’État turc. L’expérience kurde de travail de mémoire autour du génocide nous éclaire, avant tout, sur l’importance des temporalités attachées à ce type de processus. Le moment de « paix » (schématiquement 1999 à 2015) et le retour de la guerre (à partir de 2015) déterminent le cadre large et les conditions de ce travail de mémoire. Chaque pas franchi vers une solution démocratique à la question kurde voit également avancer la cause de la reconnaissance du génocide des Arméniens.
La période relativement pacifiée de la fin des années 1990 à 2015 a très largement favorisé les débats, discussions et publications émanant de la société civile et des groupes minorisés, parmi lesquelles l’évocation et le questionnement sur la réalité d’un passé génocidaire à l’emprunte indélébile sur l’histoire et la trajectoire de la Turquie. Surtout, on a vu comment, via les effets de la mémoire multidirectionnelle (par lesquels les prises de parole issues de différents groupes à propos des torts subis produisent des résonances et suscitent la remémoration et la mise en récit chez d’autres groupes, avec des effets d’amplification mutuelle), la mémoire de 1915 et celle des violences étatiques subies par les Kurdes tout au long du XXe siècle en sont venues à s’unir dans un régime victimo-mémoriel commun durant cette période.
Hélas, depuis la reprise de la guerre contre le mouvement kurde au printemps 2015 la violence étatique, militaire et judiciaire, s’est à nouveau abattue massivement. Dans cet assaut, aucun des acteurs individuels ou institutionnels qui œuvraient pour la défense des droits ou pour la confrontation avec le passé n’ont été épargnés. Une vague de menaces et de condamnations a conduit les figures emblématiques de l’engagement civique et politique au Kurdistan de Turquie, parmi des milliers d’autres anonymes, sur les routes de l’exil ou derrière les barreaux, tandis que, sur le terrain, la guerre détruisait physiquement toutes les traces et tous les symboles du réveil de mémoire dont ils avaient été les acteurs, en une entreprise d’éradication qui a pu faire parler de mémoricide.[21] Cette expérience post-2015 en Turquie met en évidence l’interconnexion profonde et inextricable entre la reconnaissance du génocide des Arméniens, la lutte pour les droits des Kurdes et l’évolution démocratique possible en Turquie. La structure imbriquée de ces trois volets est un aspect qui doit être pris en considération dans les travaux sur la mémoire et la reconnaissance du génocide des Arméniens.[22]
Malgré la tentation de considérer le quasi-anéantissement du travail de mémoire sur 1915 et le passé multiculturel comme un « dommage collatéral » de la reprise des hostilités contre les acteurs de l’émancipation au Kurdistan dans ces formes les plus répressives et brutales à partir de 2015, le retour en force de l’arsenal judiciaire pour museler les prises de paroles relatives au génocide depuis 2018, avec une vague de poursuites qui dépasse en ampleur celle de la première période, montre qu’on ne peut le réduire à cela.
Deuxième vague d’enquêtes et de procès contre les auteurs de déclarations reconnaissant le génocide des Arméniens (2018 à nos jours)
Depuis 2018, après une parenthèse de près d’une décennie ou personne n’avait été inquiété pour des propos ou publications sur la question arménienne en vertu de l’article 301 (ni d’aucun autre), 15 enquêtes ont été ouvertes à l’encontre d’écrivains, éditeurs, avocats, chercheurs, politiciens ou journalistes[23]. Les deux tiers de ces enquêtes (10 sur 15) ont obtenu du ministère de la Justice l’autorisation requise pour intenter des procès. Dans ce contexte, plus de cent personnes ont été poursuivies ou jugées (dont certaines simultanément dans plusieurs affaires). Contrairement à la période précédente, durant laquelle les cibles étaient toujours des figures emblématiques attaquées à titre individuel, cette fois, non seulement des individus mais des institutions font l’objet de poursuites souvent répétée, à l’image du barreau de Diyarbakir visé par sept enquêtes consécutives.
L’emploi de l’article 301 contre les activités commémoratives et de recherche
Le premier signe annonciateur de la fin de la période de liberté d’expression relative au génocide a été l’empêchement à Istanbul de l’événement commémoratif de la commission contre le racisme et la discrimination (Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon), le 24 avril 2018. Cette commission, créée en 2005 au sein de l’Association pour les droits de l’homme (İnsan Hakları Derneği, İHD) avait initié l’année de sa fondation la première commémoration officielle du génocide en Turquie[24], sous la forme d’une conférence de presse. Depuis lors, chaque année à cette date, l’İHD, rend hommage aux victimes arméniennes, sous différentes formes. Ces commémorations ont pris depuis 2010 un caractère public (par exemple en se rendant sur les lieux où les intellectuels arméniens ont été détenus avant d’être envoyés à la mort, etc.). Mais le 24 avril 2018, la police a empêché la tenue de cette commémoration et interdit la marche sous prétexte que les participants portaient des affiches sur lesquelles était écrit le mot « génocide »[25] (alors que le mot avait été utilisé sans discontinuité et sans poursuites dans toutes les commémorations depuis 2005). Bien que les trois militants et militantes de l’İHD arrêtés à cette occasion aient par la suite été relâchés et que le procureur général d’Istanbul ait décidé de ne pas engager de poursuites[26] en se référant aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à la liberté d’expression[27], cet empêchement de la tenue publique de la commémoration est devenu une interdiction officielle l’année suivante, obligeant l’İHD à retourner aux formes commémoratives antérieures, sous forme de conférence de presse privée dans ses locaux.
En 2019, deux affaires montrent que le vent de la liberté d’expression a bel et bien tourné. J’aborderai brièvement celle par laquelle je suis directement concerné avant de me concentrer sur la série de poursuites intentées depuis cette date au Barreau de Diyarbakır.
Co-auteur avec Namık Kemal Dinç d’un livre de recherche en histoire orale sur la mémoire locale de 1915 dans la région de Diyarbakır[28], une enquête a été ouverte en mai 2019 contre nous, incluant les quatre membres du comité de rédaction de la maison d’édition qui avait assuré la réédition du livre en 2018 (Zan Vakfı), alors même que la première édition (par la fondation İsmail Beşikçi en 2015) n’avait suscité aucune poursuite. Après avoir fait valoir que « dans les conditions sociales et politiques de l’époque, entre les années 1914 et 1918, sous l’influence de certains États impériaux, les citoyens arméniens au sein de l’Empire ottoman se sont mobilisés dans le but, tout d’abord, d’améliorer leur situation, en demandant d’abord l’autonomie, puis en aspirant à l’indépendance » et que c’est dans ce contexte qu’ « en réaction aux rébellions et aux activités de certains comités, l’État ottoman a réagi en adoptant une politique de réinstallation forcée », le procureur d’État de Diyarbakır qui instruit l’enquête et motive la demande d’autorisation d’intenter des poursuites s’appuie sur 22 citations tirées de différentes pages du livre qui peuvent selon lui « être considérées comme relevant de l’insulte publique envers la nation turque, l’État de la République de Turquie et la Grande Assemblée nationale de Turquie ». L’enquête a dans notre cas débouché au bout de trois ans sur un non-lieu : aucune poursuite n’a finalement été engagée.
Bien qu’aucune des citations incriminées n’aient été tirée de la postface ajoutée à cette seconde édition, nous avons émis l’hypothèse que c’est celle-ci qui avait motivé l’ouverture d’une enquête à l’encontre de notre livre (nous y arguions que la guerre et des destructions opérées dans le quartier de Sur à Diyarbakir par l’armée turque en 2016 avaient été non seulement une opération militaire disproportionnée mais aussi et peut-être surtout la mise en œuvre d’un mémoricide). Cependant, les poursuites intentées la même année contre le Barreau de Diyarbakir pour des propos ou écrits eux aussi rendus publics plusieurs années auparavant, nous invite à penser que le retour en force de l’usage de l’article 301 dans des cas relatifs au génocide, relève d’une dynamique plus large.
Le Barreau de Diyarbakır à la barre
Les démêlés judiciaires du Barreau de Diyarbakır méritent que l’on revienne sur le rôle fondamental de cette association d’avocats en matière de reconnaissance du génocide des Arméniens.
Fondé en 1927, le Barreau de Diyarbakır est devenu un acteur important dans la lutte pour les droits, [29] en particulier dans la lutte politique kurde qui s’est développée depuis les années 1980. Avec l’Association des droits de l’homme de Turquie, le Barreau est à Diyarbakır l’une des organisations les plus actives dans la lutte contre les violations des droits. Environ 1800 avocats y sont affiliés. En particulier depuis les années 1980 et dans la décennie 1990, plusieurs de ses dirigeants et des centaines de ses membres ont été inquiétés, menacés, poursuivis.
Alors que depuis 2013 le Barreau de Diyarbakır rend chaque 24 avril hommage aux victimes de 1915 à travers des communiqués de presse, ses déclarations commémorative ont entraîné depuis 2019 l’ouverture de sept enquêtes au titre de l’article 301, dont cinq suivies de poursuites (parmi lesquelles quatre se sont à ce jour soldées par des acquittements).[30]
Pour mieux comprendre le cheminement qui a conduit à l’instruction de ces procès, il faut revenir un peu en arrière. Tout a commencé avec une conférence intitulée « Les Arméniens de Diyarbakır à l’occasion de l’anniversaire de la déportation [tehcir] » le 23 avril 2013, à un moment où le processus de paix entre le PKK et l’État turc suscitait de grands espoirs. La conférence, organisée par le Barreau de Diyarbakır avec la contribution de la municipalité métropolitaine, s’est déroulée en présence de l’historien et écrivain Ara Sarafian, directeur de l’Institut Gomidas à Londres, et du président du Barreau, Tahir Elçi. Après la conférence, les écrivains et les intellectuels présents ont jeté des fleurs dans le Tigre, à l’endroit où 635 Arméniens de Diyarbakır avaient été embarqués sur des kelek (radeaux) du Pira Deh Derî/On Gözlü Köprü (« Le pont aux dix yeux).[31]
Le discours prononcé par Tahir Elçi à cette occasion est important pour nous à bien des égards. Tout d’abord, il s’agit de la première déclaration détaillée sur le génocide des Arméniens de la part d’un magistrat renommé, avocat et bâtonnier du Barreau. Il se clôt par ces mots : « Je partage la douleur du peuple arménien, je condamne le crime de génocide et je souhaite un monde où la vérité est regardée en face et la justice rendue ».[32] Deuxièmement, le texte de ce discours fournit le fil directeur et structure le cadre interprétatif des textes commémoratifs qui seront à l’avenir publiés par le Barreau.
En avril 2015, lors de la commémoration du centenaire du génocide à Diyarbakır, le processus de paix avait déjà pris, certes, du plomb dans l’aile, mais nous n’étions pas encore revenus au conflit ouvert. C’est dans ce contexte fragile que le Barreau de Diyarbakir, l’IHD, l’Institut Gomidas et un certain nombre d’autres organisations de la société civile ont préparé le programme de la commémoration, déroulé sur trois jours. Le 22 avril, l’un des sites du massacre des Arméniens à Chungus a été visité, des œillets y ont été déposés. Le lendemain, des bougies ont été allumées et un récital de piano donné en hommage aux victimes dans le quartier de Sur, à l’église Surp Giragos, restaurée durant la décennie précédente par la municipalité métropolitaine de Diyarbakir et la Fondation arménienne, et rouverte au culte depuis 2011. Le 24 avril enfin, la plus grande commémoration du génocide à ce jour s’est déroulée dans les ruines de l’église Surp Sarkis, toujours dans le quartier de Sur.[33] Des discours ont été prononcés ce jour-là par quatre personnalités importantes du mouvement kurde :Tahir Elçi, président du Barreau de Diyarbakır, (assassiné peu après) ; Gultan Kişanak, maire de Diyarbakir (actuellement en prison) ; Selahattin Demirtaş, alors coprésident du HDP (actuellement en prison) ; et Selma Irmak, coprésidente du Congrès de la société démocratique (actuellement en exil).
L’assassinat de Tahir Elçi, avocat de 49 ans, militant de la cause kurde, président du Barreau depuis 2010, tué en pleine rue d’une balle dans la tête le 28 novembre 2015 six mois cette commémoration dont il avait été l’un des principaux artisans, a suscité un immense émoi au Kurdistan. L’assassinat a eu lieu alors qu’il donnait une conférence de presse pour protester contre la violence et les destructions opérées par les snipers et l’armée turque quelques semaines plus tôt dans le quartier historique de Sur, à l’occasion de ce qui a été appelé « la guerre des tranchées ». Il avait été interpellé, mis en examen et placé sous contrôle judicaire peu avant pour avoir affirmé à la télévision, à la mi-octobre, que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en guerre depuis trente ans contre l’État turc, n’était pas « une organisation terroriste », une déclaration passible de 7 ans de prison, qui a probablement été la motivation principale de son assassinat.
Cet événement s’est inscrit dans une séquence plus large de violences et dévastations systématiques dans le cadre de la répression militaire dans les villes kurdes, au cours de laquelle le travail de mémoire concernant le génocide des Arméniens, qui avait connu son apogée dans la relative (bien que déclinante) « atmosphère de paix » de 2015, s’est complètement interrompu. Avec la guerre, la présence de l’armée turque, les couvre-feux, aucune commémoration n’a été organisée à Diyarbakır en avril 2016, aucun texte commémoratif n’a non plus été publié par le Barreau. Le fil de publications commémoratives du Barreau reprend l’année suivante, avec un texte publié le 24 avril 2017 « 24 avril – La grande catastrophe : nous partageons la douleur du peuple arménien », version abrégée du texte de la conférence prononcée par Tahir Elçi en 2013.
Enquêtes et poursuites de journalistes
Dans la foulée, et bien que les enquêtes se soldent par des non-lieux, ou les poursuites par des acquittements, quatre journalistes ont également été inquiétés au titre de l’article 301 à partir de 2020, pour des écrits remontant parfois à plusieurs années en arrière. Deniz Yücel, journaliste pour le journal allemand Die Welt, fut inculpé (puis acquitté) en 2021 pour avoir employé l’expression “génocide contre les Arméniens” dans un article du 27 octobre 2016.
Suite à une plainte déposée en 2020 par un citoyen auprès du Centre présidentiel de communication (CİMER, une plateforme numérique mise en place en 2015 pour faciliter les signalements et dénonciations en ligne concernant tous types d’infractions) six articles comportant le mot « génocide » publiés par trois journalistes (Elif Akgül, Haluk Kalafat et S.K) sur le site d’information Bianet ont à leur tour fait l’objet d’enquêtes, débouchant l’année suivante sur l’inculpation des trois journalistes. Deux d’entre eux ont été acquittés, tandis qu’un troisième est toujours en attente de jugement, l’audience ayant été reportée au 9 mai 2024.
Même en cas de non-poursuite ou d’acquittement, il importe d’avoir à l’esprit combien handicapantes peuvent être les enquêtes et les poursuites pour les personnes visées : menace de saisie du passeport et d’interdiction de sortie du territoire, conséquences possiblement néfastes dans le milieu professionnel lorsque les noms sont rendus publics ou dévoilés par la presse, incertitude sur la durée des procédures et risque d’une condamnation plus ou moins lourde, jamais exclue en dépit des jurisprudences sur lesquelles peuvent s’appuyer les avocats de la défense, telles les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme en 2008 et 2011 dans les affaires Hrant Dink et Taner Akçam, et plus récemment, la décision d’acquittement prononcée en mai 2018 par du procureur général d’Istanbul au nom de la liberté d’expression dans le cadre de l’affaire Deniz Yücel. Le tout a d’importantes répercussions sur la vie des personnes menacées de poursuites et leurs proches. Me concernant par exemple, l’enquête ouverte à mon encontre, bien que n’ayant débouché sur aucune poursuite ou condamnation, m’a dissuadé de retourner en Turquie pendant deux années.
On peut supposer que, davantage qu’une volonté de condamner (la Justice n’accédant quasi jamais aux demandes de peines réclamées par les procureurs), l’objectif gouvernemental en accordant de plus en plus d’autorisations de poursuites contre des personnes souvent anonymes pour des propos finalement devenus communs, est d’alimenter un climat de risque permanent susceptible de conduire à un retour de l’autocensure. Tous les avocats du Barreau que j’ai interviewés se rejoignent sur une idée : la Justice choisit délibérément de ne pas punir dans ces affaires. Elle préfère l’éviter pour ne pas attirer l’attention internationale sur la question. Cependant, la volonté étatique de criminaliser et de dissuader étant intacte, l’État continue d’intenter des poursuites contre certaines personnes et institutions œuvrant pour ce travail de mémoire.
Attaques contre des acteurs collectifs d’envergure nationale
Concernant la reconnaissance du génocide de Arméniens, l’année 2021 est particulièrement importante. Le 24 avril de cette année-là, le président des États-Unis, Joe Biden, annonce la reconnaissance officielle du génocide de 1915 par son pays. Cet événement a suscité de vives et hostiles réactions à l’échelle de la Turquie, et eu de nouvelles conséquences néfastes pour les acteurs du travail de mémoire en Turquie, accusé de « faire le jeu des impérialistes ». Dans ce contexte, le caractère de cible de ceux qui qualifient les événements de 1915 de « génocide », notamment parmi les acteurs les plus emblématiques, a été renforcé. Les procès intentés en 2021 sont sans doute ceux où l’interaction/la coïncidence entre la volonté politique de la sphère gouvernementale et les décisions de l’institution judiciaire sont les plus évidents.
Le 24 avril 2021, l’Association des droits de l’homme (İHD) et le Parti démocratique des peuples (HDP), ont, comme à leur habitude, partagé des déclarations solennelles commémoratives employant le terme « génocide ». Le jour même, le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu réagit en publiant sur son compte Twitter une capture d’écran des deux déclarations, accompagnée d’un bref message scandalisé : « La soi-disant Association des droits de l’homme (İHD) et le HDP ont déclaré : “reconnaissez le génocide, demandez le pardon et la compensation”. L’İHD et le HDP sont unis dans leur opposition à la Nation et à l’Histoire… ».[34]
Quelques mois plus tard, quatre déclarations commémoratives, dont les deux visées par Soylu, ont fait l’objet d’ouvertures d’enquête, dont trois ont débouché sur une autorisation de poursuites judiciaires.
La première enquête ouverte en 2021 visait Öztürk Türkdoğan, coprésident de l’Association des droits de l’homme (İHD), pour sa déclaration publiée sur le site web de l’association le 24 avril 2017 « Mettre fin à la négation du génocide des Arméniens pour la justice et la vérité ! », « détectée suite à une dénonciation »[35] et attaquée au titre de l’article 301. Türkdoğan a été acquitté en 2023.
Les trois autres enquêtes intentées en 2021 concernaient les déclarations respectives effectuées le 24 avril de l’année même par des membres de l’İHD et du HDP.
Yakup Ataş, avocat et président de la branche provinciale de l’İHD à Adana, est le premier depuis près de deux décennies à avoir été attaqué pour ses propos au sujet du génocide, non pas au titre d’insulte à la nation (article 301) mais pour « incitation du public à la haine et à l’hostilité » (article 216 du code pénal turc). Il s’est défendu devant le tribunal d’Adana le 15 septembre 2021, en rejetant les accusations, arquant qu’il n’avait exprimé que son « opinion personnelle », et que ses déclarations étaient protégées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en vertu de la liberté d’expression. Dans son cas une décision de non-poursuite a été rendue, motivée par le fait que l’ensemble de la déclaration faite au nom de la branche d’Adana de l’İHD était protégée par la liberté d’expression.[36]Ataş a par la suite déclaré que l’enquête visait à intimider les militants des droits de l’homme et souligné le déclenchement de l’enquête à la suite du tweet du ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu.
Une autre enquête a parallèlement visé la coprésidente du İHD, Eren Keskin, et une membre de la Commission contre le racisme et la discrimination de l’İHD, Güllistan Yarkın (au titre de l’article 301) pour la commémoration du génocide arménien en 2021. Celle-ci a en revanche débouché sur une inculpation en 2023. L’acte d’accusation préparé par le procureur vise : « L’ensemble du communiqué de presse du 24 avril 2021, et en particulier la déclaration suivante : “Plus important encore, la Turquie a réalisé la négation du génocide la plus réussie et la plus durable au monde, l’a institutionnalisée et diffusée au plus grand nombre. Le déni a été si efficace qu’aujourd’hui les Arméniens sont contraints de prouver leur existence depuis des milliers d’années, sans parler du fait qu’ils ont été victimes d’un génocide dans leur propre patrie.” » L’affaire est toujours en cours et la prochaine audience est prévue pour le 2 mai 2024.[37]
Le dernier procès été intenté en 2021, lui aussi au titre de l’article 301(TCK) a visé 11 membres du comité central exécutif (MYK) du Parti démocratique des peuples (HDP), pour la déclaration « Faites face à la honte du génocide des Arméniens ! » publiée sur le site officiel du HDP le 24 avril 2021. L’enquête, déclenchée par une dénonciation, a débouché sur une inculpation le 30 novembre 2022. Lors de la quatrième audience, le 21 mars 2024, le juge de première instance a annoncé le verdict et a condamné 10 personnes à 5 mois d’emprisonnement avec sursis.[38] Les membres de la Commission ont fait appel, l’affaire est donc toujours en cours. Néanmoins, des 15 enquêtes ouvertes depuis 2018 pour des commémorations, déclarations de presse, livres, reportages ou interviews sur le génocide arménien, c’est la première affaire qui aboutit à une condamnation.
Les enquêtes ou procès ouverts contre les membres d’İHD et HDP doivent être distingués, en termes de poids, d’impact et de signification, de ceux visant des auteurs ou journalistes, qui revêtent une dimension personnelle. L’İHD et le HDP sont deux organisations d’envergure nationales, actrices, emblématiques de l’opposition, sous un régime de plus en plus autoritaire au fil des jours. Toutes deux étaient déjà sous le feu judiciaire, avec des enquêtes, procès et condamnations ne cessant de se multiplier contre leurs membres, surtout depuis 2015. Mais cette fois c’est pour pour leur engagement actif dans la commémoration qu’elles ont été ciblées. Ces décisions sont très importantes au plan symbolique : l’İHD commémore le génocide depuis 2005, mais l’ouverture des procès en 2021 montre que l’arsenal judiciaire est prêt à être déployé massivement contre ce dernier bastion de la liberté d’expression. Enfin, la condamnation des 10 membres du HDP marque un tournant dans l’utilisation de cette arme judiciaire. Le fait que ce soient précisément des membres du HDP qui aient été condamnés pour la première fois montre les lignes rouges qui définissent qui peut commémorer le génocide en Turquie, et comment.
Comment comprendre la multiplication de ces attaques ?
La seconde vague de poursuites, toujours en cours à l’heure actuelle, doit être éclairée au prisme des importants changements de contexte et de conjoncture intervenus à plusieurs nivaux depuis la fin de la première vague en 2009.
Pour analyser cette deuxième vague de mobilisation de l’arme judiciaire par l’État turc à l’encontre des militants et organisations impliqués dans la reconnaissance et le travail de mémoire du génocide des Arméniens, il faut prendre en compte en premier lieu les changements radicaux ayant affecté la Turquie en matière de politique intérieure.
Le second mandat d’Erdoğan a clairement été celui du tournant autoritaire. Concernant la question kurde, on est passé des espoirs de résolutions inédits au début de la décennie 2010 à un retour aux politiques répressives digne des pires années de guerre du siècle précédent. De même l’« ouverture démocratique » envers les minorités a cédé le pas au retour des politiques racistes. Le coup d’État manqué de 2016 et le retournement contre les anciens alliés gülénistes ont ouvert la voie à des politiques de purge à grande échelle visant toute opposition et ne cherchant plus à masquer les violations systématiques des droits de l’homme dans leur mise en œuvre. Une campagne « politicide » brutale a visé le mouvement kurde. Par ailleurs, les luttes internes aux sphères du pouvoir se sont très largement déplacées par rapport à la période précédente : le bloc turco-islamiste, après de multiples victoires contre le bloc turco-kémaliste, est désormais ouvertement allié des partis de la droite ultranationaliste turque la plus extrême (notamment le MHP, dont est par exemple issu le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu dont il a été question plus haut).
Les changements survenus concomitamment au niveau géopolitique plus large sont également d’une importance capitale pour comprendre le contexte qui préside à cette multiplication des attaques judiciaires. D’une part la page « européenne » semble définitivement tournée.[39] Avec la crise au sein de l’OTAN, la Turquie s’est également rapprochée de la Russie, et ne cache plus ses ambitions irrédentistes (Lybie, Syrie, Irak, Arménie…). Il faut également tenir compte des répercussions énormes de l’éclatement de la seconde guerre du Haut-Karabagh en septembre 2020, opposant la République autoproclamée du Haut-Karabagh (Artsakh), soutenue par l’Arménie, à l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Le soutien logistique, politique et moral de la Turquie à l’Azerbaïdjan a non seulement étouffé toute voix pacifique s’élevant contre ce conflit, mais a également entravé les efforts visant à perpétuer la mémoire du génocide arménien, qui, d’enjeu symbolique concernant le passé, devenait soudain également instrument et enjeu géopolitique d’un conflit armé des plus actuels. Enfin, la reconnaissance officielle du génocide des Arméniens par les États-Unis en avril 2021 a achevé de conforter le retour d’une grille de lecture binaire opposant les blocs antagonistes Orient/Occident et Chrétienté/Islam.
•
Comment interpréter la spécificité et la temporalité de ces deux périodes particulières où les enquêtes et poursuites judiciaires sont intensifiées contre le travail de mémoire lié au génocide ? D’abord, il faut souligner certaines différences essentielles. La période 2004-2008 était caractérisée par une forte concurrence entre le bloc turco-kémaliste (issu de la tradition de la raison d’État par excellence, piliers de l’État profond), et le bloc turco-islamistes à l’époque « modérés » soudé autour de l’AKP, qui venait d’accéder au pouvoir. Nouvellement arrivé au gouvernement, les seconds n’avaient pas encore acquis un contrôle effectif sur le pouvoir judiciaire, tandis que les premiers mobilisaient leur influence au sein du pouvoir judiciaire pour reproduire la raison de l’État. C’est ainsi des acteurs tels que Doğu Perinçek, Kemal Kerinçsiz, Veli Küçük, éminences de l’État profond, sont apparus soudainement sur la scène publique pour intimider, criminaliser, et même faire assassiner les courageux artisans de la rupture du tabou sur le génocide arménien.
La modification de l’article 301 du code pénal turc par l’AKP en 2008 (conditionnant l’introduction d’une action en justice au titre de l’article 301 à l’obtention d’une autorisation du ministre de la Justice) était une riposte visant à freiner cette campagne de déni turco-nationaliste. Pour autant, il est évident que c’est surtout la réaction massive et généralisée des forces démocratiques en Turquie à la suite de l’assassinat de Hrant Dink qui a encouragé l’AKP à limiter la campagne des nationalistes orchestrée par une coalition d’acteurs de l’État profond. La seconde période de l’utilisation de l’arme judiciaire via l’article 301 contre les acteurs engagés dans le travail de mémoire pour la reconnaissance du génocide des Arméniens survient dans un contexte profondément différent à de multiples niveaux : depuis le début de son deuxième mandat, et surtout après le référendum constitutionnel de 2010, l’AKP a largement pris le contrôle des institutions de l’État, y compris le pouvoir judiciaire.
Comment expliquer la fermeture de la parenthèse de dix ans d’accalmie dans l’utilisation de l’article 301 pour pénaliser le travail de mémoire relatif au génocide ? Nous avons déjà insisté sur l’importance de changements survenus en matière de politique intérieure (tournant autoritaire) et extérieure (changement profond et assumé de nouvelles ambitions et alliances géopolitiques « annexionistes »). Nous devons également souligner le rôle (crucial mais différent) des acteurs de l’extrême droite nationaliste issue de MHP dans chacune des deux périodes : leur rôle est décisif dans l’usage de l’arme judiciaire dans les deux cas. Actifs aux côtés du bloc turco-kémaliste et de l’État profond en tant que force oppositionnelle à l’AKP durant la première période, c’est désormais en tant qu’alliés du parti gouvernemental qu’ils défendent l’histoire officielle ;et on peut voir les ministres de la Justice de l’AKP, accéder sans guère de restriction aux demandes d’autorisations de poursuites. Quant au CHP, issu de la tradition kémaliste et nationaliste devenu principal parti d’opposition, bien qu’il ait adopté un discours plus libéral et démocratique ces derniers temps, n’a pas changé son discours négationniste sur 1915. Tout ceci nous amène à faire le constat, en dépit des avancées énormes du travail historique et mémoriel sur la scène publique de Turquie, de la quasi-unanimité persistante de l’ensemble des forces politiques du pays pour nier le génocide : en dehors de quelques petits partis de gauche et du mouvement kurde, les deux blocs hégémoniques en concurrence en Turquie (AKP+MHP vs CHP), continuent de défendre avec acharnement les bases du négationnisme, qui fait partie du « pacte de turcité ».
ANTHROPOLOGUE, CHERCHEUR POSTDOCTORAL À L’INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES EN SCIENCES HUMAINES (KWI) DE L’UNIVERSITÉ DUISBURG-ESSEN

